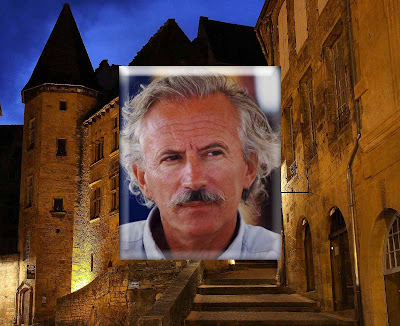concerts de septembre
Non content d'avoir des belles dispositions de directeur artistique, Yann a aussi, c'est indéniable, de grandes qualités "d'hôte" : il accueille chacun de nous comme un ami proche et attendu... du coup, comment oser rater un concert ??? La file d'attente pour écouter Laloum était à la hauteur du talent de l'artiste !
Je saluais il y a peu le talent de directeur artistique de Jean-Paul Tribout à Sarlat, insistant sur le fait que pour nous, spectateurs lambdas, ni journalistes bobos ni happy few de l'élite intellectuelle qui se pique de modernisme, le "bon goût" des programmateurs est primordial. Et, en la matière, nous devons une fière chandelle à "notre" programmateur des Jeudis Musicaux, qui nous concocte des grilles de concerts aux petits oignons, avec, toujours, des interprètes de talent. Que grâces soient, une fois de plus, rendues ici au "bon goût" de Yann Le Calvé qui nous régale pendant 4 mois !
C'est tout une logistique que ce "petit" Festival : deux sites de concert chaque jeudi, un au "nord", l'autre au "sud" (ça c'est chez nous !) et une équipe très rodée qui y fait merveille.
JEUDIS MUSICAUX DE ROYAN : Jeudi 13 juin
Récital de violon de Pierre Fouchenneret à Vaux-sur-Mer : pour un programme de sonates et partitas de Bach : ce tout jeune homme, né en 1985 à Grasse et qui fit ses études au conservatoire de Nice (qui sait, Martine le connait peut-être !) débarque sur scène en agitant sa crinière indisciplinée, se concentre sur son instrument et se "jette" dans Bach avec l'ardeur des amoureux ! Un programme exigeant et superbe qu'il a servi avec beaucoup de fougue et d'inspiration.
JEUDIS MUSICAUX DE ROYAN : Jeudi 27 juin à Arvert
Récital de piano d'Adam Laloum : cela avait beau être le tout début de la saison, Laloum à Arvert, il nous fallait arriver assez tôt pour ne pas risquer de nous voir refouler pour cause de jauge de la salle atteinte : dans ces cas-là, les pompiers et autres autorités municipales sont imptoyables : on vous renvoie dans vos foyers sans état d'âme. Donc à 19h30, nous étions devant l'église avec notre pique-nique, ce qui nous a valu de le manger en écoutant la fin de la répétition, puis de voir sortir ce tout modeste pianiste, aussi modeste que son talent est grand. Gros comme une crevette dirait mon amie Madeleine ! Mais quelle énergie et surtout, quel souffle. La musique sort de lui comme une exaltante expression de l'âme. La sienne, et la nôtre par la même occasion. Ecouter Adam Laloum, c'est une méditation, une approche toujours renouvelée des pièces qu'il exécute, surprise et bonheur mêlés. A Arvert, il nous a "donné" un Schumann admirable et un Schubert, pourtant abominablement difficile à interpréter, absolument parfait. J'aimerais un jour l'entendre dans la nouvelle formation en trio qui a fondée avec Mi-sa Yang et Victor Julien-Laférierre : le trio "les Esprits". Nous l'avions découvert à La Roche Posay, (il était tout jeune alors et pas encore connu) en musique de chambre, et il y faisait merveille.
Les "Jeudis", c'est aussi le pot d'après concert ! Mention particulière pour le pot de Chaillevette, avec galette charentaise moelleuse aux abricots et punch bien frais !
JEUDIS MUSICAUX DE ROYAN : Jeudi 18 juillet à Semussac
Récital de piano de Claire-Marie Le Guay : cette jeune et jolie pianiste nous avait concocté un programme un peu déroutant, et paraissant de bric et de broc, sans vraie logique musicale. Et si elle excellait dans certains morceaux (elle a, en particulier, donné une interprétation absolument inoubliable de Saint François de Paule marchant sur les eaux, tellement imagée, tellement colorée qu'on se serait cru au "cinémascope" !! c'était exaltant !), d'autres pièces étaient manifestement peu préparées ou mal choisies (comme les arrangements de Bach par Busoni, pas notre tasse de thé d'ailleurs et, ce soir là presque hésitants).
FESTIVAL DE SAINTES : Vendredi 19 juillet
Récital de piano de Bertrand Chamayou : pourtant nous sommes des aficionados de Chamayou, mais nous nous sommes ennuyés. Je peux, je crois, me permettre de le dire car j'ai souvent encensé ce pianiste (là, ou là) et je reste une inconditionnelle. Mais ce soir-là, la sauce n'a pas pris pour nous. Certes, la technique était parfaite, au-dessus de tout soupçon. Le jeu était impeccable, il n'a ménagé ni son énergie, ni les nuances de son talent. Mais nous ne l'avons pas trouvé très convaincant dans Schubert, qu'il a abordé avec un peu trop de "muscle". Quant à Wagner, rien à redire en ce qui concerne Chamayou, là c'est le compositeur qui nous laisse de marbre. Du coup, à la sortie, nous n'étions guère au diapason avec Arlette et avec Gérard, totalement enthousiastes.
JEUDIS MUSICAUX DE ROYAN : Jeudi 25 juillet à Chaillevette
Là encore, nous avions prévu une arrivée très tôt, toujours avec pique-nique, mais bien qu'ayant plus d'une heure d'avance, nous n'étions pas les premiers, loin de là. Il faut dire que le Quatuor Hermès, que nous avons découverts à Saint Roch en parlant de coup de foudre à leur sujet... pas question de les rater donc, et notre enthousiasme s'est confirmé ! Après un quatuor de Schubert joué avec une grande intelligence du texte (on sentait, dans leur interprétation la patte de Miguel da Silva !), nous avons eu une version un peu hispanisante de l'unique quatuor de Verdi. Pleine de vivacité, très fougueuse, quoique pas assez verdienne à mon goût, mais depuis que j'ai entendu les Schumann dans l'exercice, je suis devenue très difficile (désagréable même ! car c'était tout de même très bon).
Et surtout, leur interprétation du quatuor opus 41 n°3 en la majeur de Schumann était au-dessus de toute critique ! Ce quatuor est composé de quatre personnalités parfaitement complémentaires et très bien accordées : le violoniste, Omer Bouchez, est très virtuose et très concentré, tendu parfois, mais tellement précis ! Le second violon Elise Liu a un vrai caractère et elle apporte une touche de douceur pour détendre "son" premier violon, qui est un excellent liant. J'ai, personnellement, un petit faible pour le violoncelliste, Anthony Kondo qui un son ... ouaou !! un son plein, rond, grave, puissant et surtout, toujours maîtrise. L'altiste, Yung-Hsin Chang, pourrait sembler effacée ou trop en recul : mais il ne faut pas s'y tromper, elle a vraiment quelque chose à dire et n'hésite pas à prendre la parole quand la musique le réclame. Retenez : quatuor Hermès, on va parler d'eux dans les années qui viennent !
Et surtout, leur interprétation du quatuor opus 41 n°3 en la majeur de Schumann était au-dessus de toute critique ! Ce quatuor est composé de quatre personnalités parfaitement complémentaires et très bien accordées : le violoniste, Omer Bouchez, est très virtuose et très concentré, tendu parfois, mais tellement précis ! Le second violon Elise Liu a un vrai caractère et elle apporte une touche de douceur pour détendre "son" premier violon, qui est un excellent liant. J'ai, personnellement, un petit faible pour le violoncelliste, Anthony Kondo qui un son ... ouaou !! un son plein, rond, grave, puissant et surtout, toujours maîtrise. L'altiste, Yung-Hsin Chang, pourrait sembler effacée ou trop en recul : mais il ne faut pas s'y tromper, elle a vraiment quelque chose à dire et n'hésite pas à prendre la parole quand la musique le réclame. Retenez : quatuor Hermès, on va parler d'eux dans les années qui viennent !
Un bis fort original pour le quatuor Hermès : Crisantemi de Puccini, une élégie composée en 1890 pour rendre hommage à la mémoire d'Amédée de Savoie, duc d'Aoste ... moi qui suis en plein dans l'histoire des Savoie avec les Macchiaioli, j'en ai été tout chavirée ! Bien sûr la version que je vous propose n'est pas celle des Hermès.
FESTIVAL DE FONTDOUCE : Vendredi 26 juillet 2013
Pour fêter les 20 ans du Festival et pour en proclamer l'ouverture, un concert, parrainé par Philippe Cassard, tombé "en amour" du lieu, qui symbolisait la particularité de cette manifestation qui offre toujours 12 concerts : 6 de classique et 6 de jazz, le tout à raison de 2 concerts par jour.
Donc pour ce concert d'anniversaire, une première partie de jazz, avec Baptiste Trotignon pour quelques standards, des compositions personnelles et quelques improvisations sur des airs classiques (Valses de Chopin).
Puis Nathalie Dessay, accompagnée par Philippe Cassard pour une sélection très agréable de mélodies françaises : un genre désuet et charmant que j'affectionne particulièrement, c'est tellement rare, car un peu démodé. Debussy, Duparc, Poulen, Chabrier ... Mais la diva était de mauvaise humeur... la chaleur, le public bruyant, la lumière trop vive sur la "salle" (elle a réclamé un "noir salle" en riant un peu jaune puisque nous étions dehors, à 21h !!) et sa voix était fragile. Le concert a été d'une brièveté déconcertante et quelque peu frustrante, et l'on s'est dit, pour la énième fois, qu'il était stupide de notre part de courir les "noms connus", car on sait ce qui nous attend ! Pas d'émotion, juste un concert convenu. Heureusement qu'elle avait choisi des mélodies françaises, cela donnait au moins à son spectacle une authenticité de bon aloi ! On a évité les poncifs musicaux !
Pour fêter les 20 ans du Festival et pour en proclamer l'ouverture, un concert, parrainé par Philippe Cassard, tombé "en amour" du lieu, qui symbolisait la particularité de cette manifestation qui offre toujours 12 concerts : 6 de classique et 6 de jazz, le tout à raison de 2 concerts par jour.
Donc pour ce concert d'anniversaire, une première partie de jazz, avec Baptiste Trotignon pour quelques standards, des compositions personnelles et quelques improvisations sur des airs classiques (Valses de Chopin).
Puis Nathalie Dessay, accompagnée par Philippe Cassard pour une sélection très agréable de mélodies françaises : un genre désuet et charmant que j'affectionne particulièrement, c'est tellement rare, car un peu démodé. Debussy, Duparc, Poulen, Chabrier ... Mais la diva était de mauvaise humeur... la chaleur, le public bruyant, la lumière trop vive sur la "salle" (elle a réclamé un "noir salle" en riant un peu jaune puisque nous étions dehors, à 21h !!) et sa voix était fragile. Le concert a été d'une brièveté déconcertante et quelque peu frustrante, et l'on s'est dit, pour la énième fois, qu'il était stupide de notre part de courir les "noms connus", car on sait ce qui nous attend ! Pas d'émotion, juste un concert convenu. Heureusement qu'elle avait choisi des mélodies françaises, cela donnait au moins à son spectacle une authenticité de bon aloi ! On a évité les poncifs musicaux !